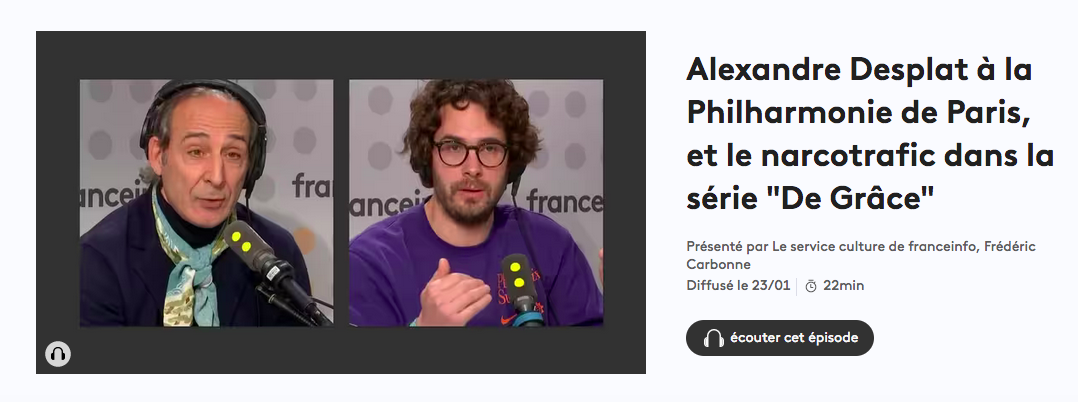Dans ma bibliothèque
Un beau moment pour un podcast dans lequel je plonge dans ma bibliothèque en compagnie de Dolly, de la librairie “Des gens qui lisent” à Sartrouville, à l'occasion de la publication de Un coup de pied dans la poussière.
Mais c'est encore Dolly qui parle le mieux de cette rencontre et de mon livre : Ceci est une rencontre suspendue. Au-dessus du bruit du monde, dans une ruche d'artistes, j'ai fait la connaissance d'un garçon encore plus enthousiaste que moi quand il s'agit de parler de livres (et il faut y aller). Quand j'ai lu le roman de Baptiste Fillon, Un coup de pied dans la poussière, en janvier dernier, j'ai été embarquée par son écriture romanesque, par l'attention et l'amour qu'il porte à son personnage principal, Nissan Rilov, peintre du 20ème siècle pacifiste et humaniste. Il m'a proposé de le rejoindre à La Ruche, un atelier d'artistes du 14ème arrondissement dans lequel a vécu et travaillé le personnage de son livre. C'était magique de parler de littérature dans cet endroit, peuplé de tant d'autres vies, de tellement d'histoires. C'était magique de s'échapper soudain dans un roman, dans un personnage, et de retrouver le sens qui manque si souvent à nos vies.
“Quand j’ai lu le roman de Baptiste Fillon, Un coup de pied dans la poussière, en janvier dernier, j’ai été embarquée par son écriture romanesque, par l’attention et l’amour qu’il porte à son personnage principal, Nissan Rilov,”
Parfois, quand on aime les mêmes livres, on se surprend à se reconnaître alors même qu'on se parle pour la première fois. La rencontre avec Baptiste avait ce parfum là, spontané, amical, naturel. Il y a eu des éclats de rires et des confidences, des histoires de marins au loin sur l'océan, des havres de paix et des questionnements intérieurs. Il y a eu des histoires qui nous cueillent et nous déplacent, nous emmènent là où on n'aurait pas imaginé. Il y a eu des clins d'oeil à Flaubert, Amado, Pessoa ou encore Rimbaud, et tous étaient là autour de nous dans cette conversation qui aurait pu ne jamais s'arrêter.
“Il y a eu des éclats de rires et des confidences, des histoires de marins au loin sur l’océan, des havres de paix et des questionnements intérieurs. Il y a eu des histoires qui nous cueillent et nous déplacent, nous emmènent là où on n’aurait pas imaginé. Il y a eu des clins d’oeil à Flaubert, Amado, Pessoa ou encore Rimbaud, et tous étaient là autour de nous dans cette conversation qui aurait pu ne jamais s’arrêter.”
Ce podcast est à écouter au-dessus des nuages, le regard perdu dans le ciel, vue sur la Tour Eiffel, caché dans la chambre de ses enfants ou au fond d'une librairie de bord de mer. On y entre sans savoir ce qu'on y cherche, et c'est un peu de soi-même que l'on trouve.
Merci Baptiste pour ta confiance.
Belle journée dans les livres