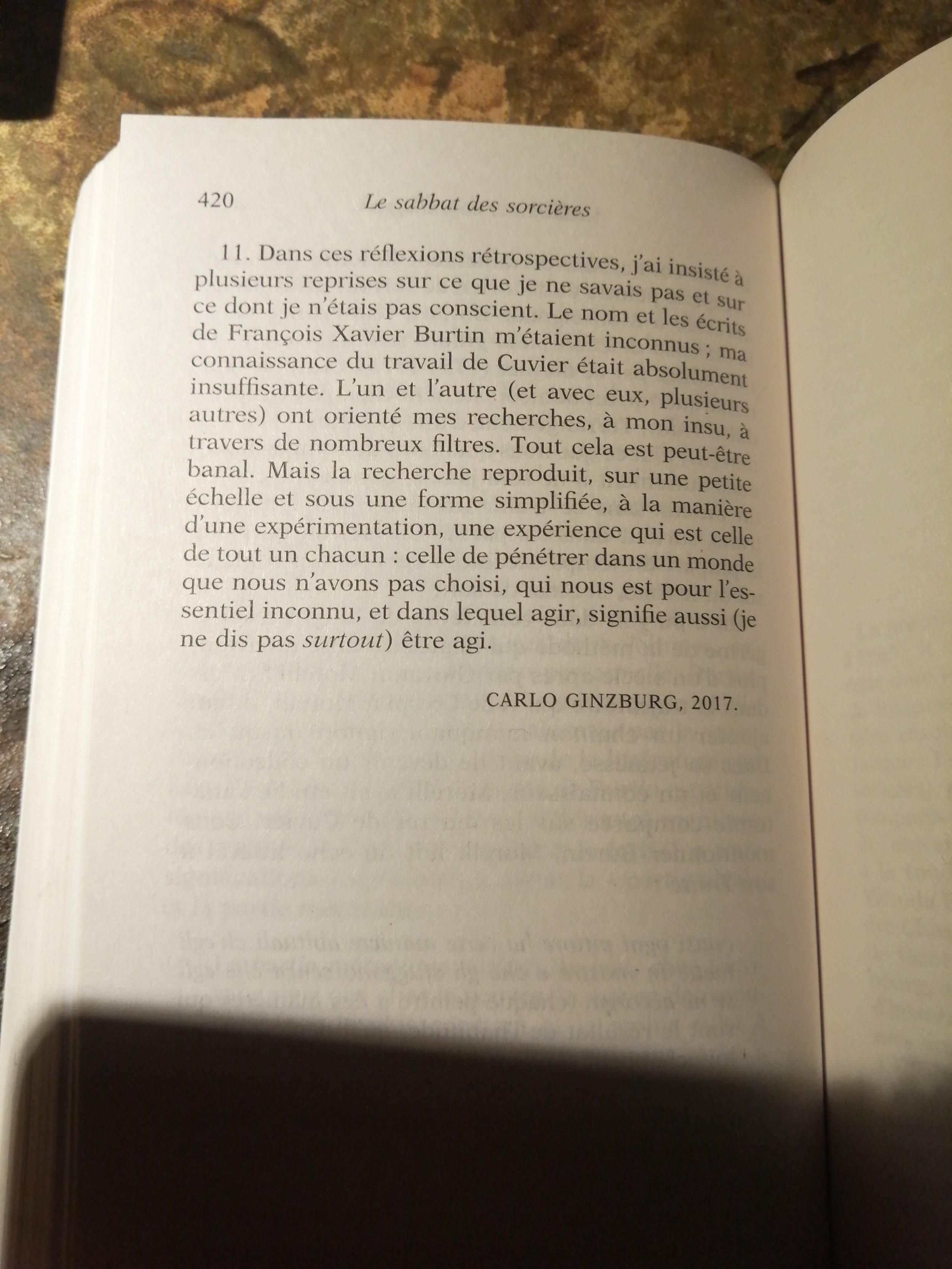Microcosmes, Claudio Magris
C’est la première fois que je lis Magris. Honte à moi, je sais. Son livre est un périple dans les pliures des frontières issues de l’Europe des canonnières, entre Croatie, Tyrol, et les endroits morts d’une Trieste qui n’en finit d’oublier qu’elle fut une brillant nulle part, entre Autriche-Hongrie et Italie, entre Mitteleuropa et Méditerranée, entre Slaves, Germains et Latins. Aujourd’hui, une ville provinciale que je connais un peu, qui soupire après son passé brillant et déglingué, notamment les deux génies qu’elle a couvés : Joyce l’arsouilleur et Svevo, le bourgeois neurasthénique.
Magris parle brillamment, de tout et de rien, de toutes les nécessaires futilités qui font une vie : fidélité à un drapeau, idiomes éventés, souvenirs incompréhensibles, amourettes en genèse. Mais ce qui m’a le plus touché, c’est sa description de Svevo, de son essence d’écrivain, quand il évoque sa statue décapitée dans le Jardin Public de Trieste :
“Cette tête manquante semble un des nombreux malentendus, erreurs, échecs, déboires et affronts qui constellent l’existence de Svevo, l’écrivain qui a scruté à fond l’ambiguïté et de le vide de la vie, voyant que les choses ne sont pas en ordre et continuant à vivre comme si elles l’étaient, dévoilant le chaos et feignant de ne pas l’avoir vu, percevant à quel point la vie est peu désirable et peu aimable et apprenant à la désirer et à l’aimer intensément
Pour ce génie - qui est descendu jusqu’aux racines les plus obscures de la réalité, qui a vu se transformer et se dissoudre toute identité et qui a vécu comme un honorable bourgeois et un bon père de famille - les choses allaient souvent de travers. Il était un “Schlemihl”, ce personnage de la tradition juive à qui on met toujours des bâtons dans les roues; un de ces malheureux irréductibles dont on dit que, s’ils se mettaient à vendre des pantalons, les hommes naîtraient sans jambes, un de ces maladroits et intrépides collectionneurs de catastrophes qui se relèvent indomptables après chaque culbute.”