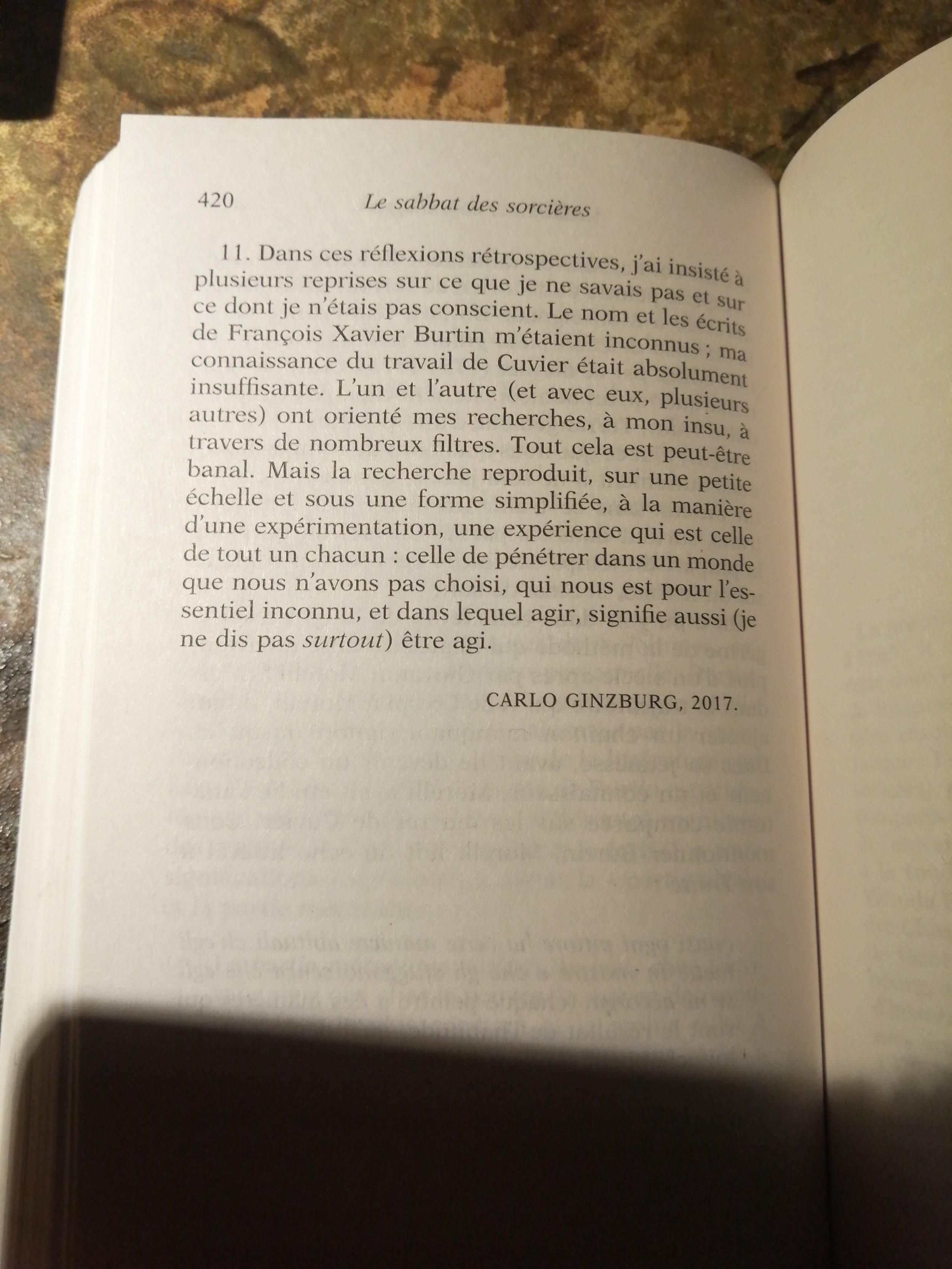Les lauriers sont coupés, Dulaurier
Quelques heures dans la vie d’un jeune homme, employé de bureau, dont la famille est provinciale. Six heures, je crois. Une belle soirée de printemps. Avril, les grands boulevards. Il est seul, personne ne l’attend. Il songe à se rendre chez sa maîtresse en fin de soirée. Une actrice qu’il entretient et avec laquelle il voudrait coucher. Le seul suspense du livre.
L’odeur des bouillons, les regards dans la rue, les espoirs d'avancement et le vertige à demi avoué d'être à une certaine place de l'éternité, vivant, sans savoir pourquoi ni au nom de quoi.
Le premier roman du monologue intérieur, sauvé de l’oubli grâce à Joyce qui encourage Larbaud à la lire en 1920. Dujardin a inspiré son Ulysse. Un court roman sur l’étourdissement constamment renouvelé d’être au monde.