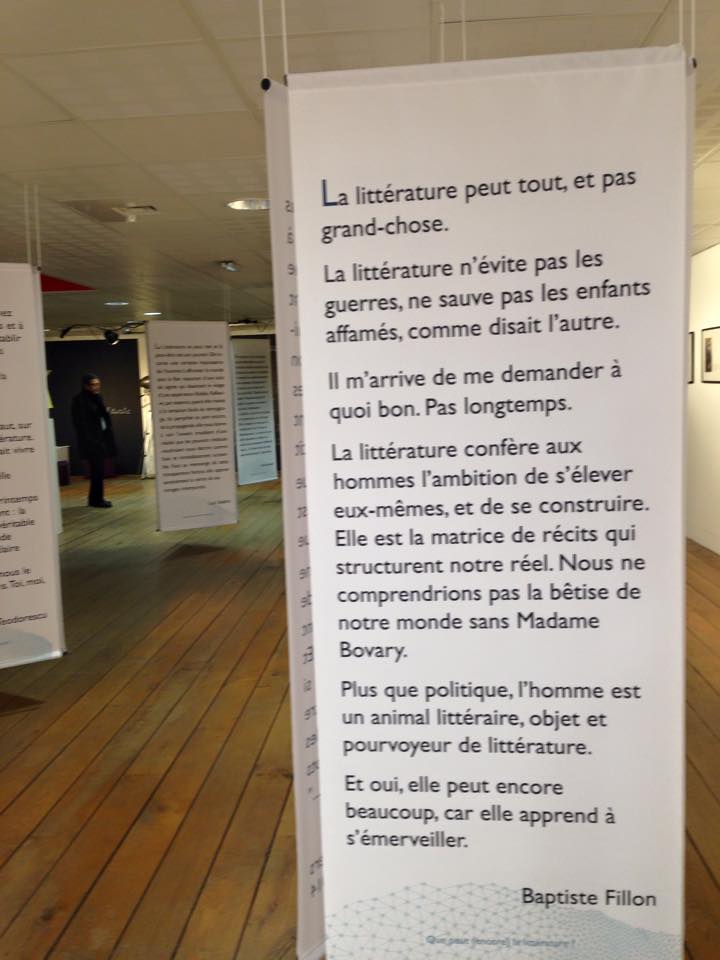L'invention de la ville par Roberto Arlt
Dans les années trente, à Buenos Aires, un écrivain de la place se doit d'appartenir au groupe de la rue Florida ou à celui de la rue Boedo : soit l’artère élégante, abritant une mouvance portée par des esthètes dont les chefs de file comptent Borges, soit la voie d’un quartier de classe moyenne, couvant une littérature tournée vers les problèmes économiques et sociaux de l'époque.
Roberto Arlt n'appartient à aucun de ces mouvements. Il est à leur confluence, et à la marge, se foutant de la politique, dégoûté par la vulgarité, sublimant la vie en éternel, et raillant les belles âmes.
Né avec le XXème siècle, mort quarante-deux ans plus tard, en pleine Seconde Guerre Mondiale, ce métisse argentin d'Italie et de Prusse, auteur de La danse du feu et du Jouet enragé, se veut un irrémédiable agnostique, considéré dans les anthologies comme "l'un des fondateurs de la littérature urbaine". Titre à la fois impropre et usurpé.
Avec Buenos Aires, l'Argentine d'alors abrite une incommensurable Babel, dont Arlt est le fruit monstrueux, une capitale sans fin, légendaire comme le pays des morts chez les Anciens. La ville borne l'horizon, sculpte les âmes, modèle la société en vomissant des masses d'ouvriers et de petits-bourgeois, mirage de la liberté, cachot aux parois aussi nombreuses que les murs des millions de bâtisses qui la composent.
Avec Onetti, Arlt est l'un des premiers à fonder en mythe cette étendue grouillant d'indifférence, saignée de sa morale, à saisir ses habitants, débarrassés de la faim, de la maladie, pourris par l'insatisfaction et l'increvable peur de ces fléaux, incapables de passion et d'amour, sauf ceux qu'ils s'échinent à éprouver pour eux-mêmes, tous avatars du héros de La danse du feu :
“Qu’il soit fort, c’est la seule chose qui compte. Rien d’autre. Qu’il soit égoïste. Et qu’il jouisse de la vie à fond, sans les stupides scrupules qui aujourd’hui l’empêchent, lui, de dormir”
Dans ses écrits personnels, Onetti décrivant l'habitant de Buenos Aires fait état du même néant métaphysique et spirituel :
“En Argentine est apparu un type d’indifférent moral, d’homme sans foi et sans intérêt pour son destin.”
Il n’existe pas de Nouveau Monde.
Arlt dépeint des êtres incrédules, portés dans leur existence par les éclats d'un scepticisme inerte, la nostalgie de toute transcendance. Son héros, Balder, abandonne femme et enfant pour suivre une collégienne. Il s'éprend de l'amour comme d'une tragédie délicieuse, ne valant que par la désillusion qu'elle fomente, la destruction dont elle surgit. Cet ingénieur, sans autre relief que son égoïsme, poursuit l'innocence dans les bras d'une jeune fille en fleurs, repoussant toujours sa première fois. Balder constitue un monde labyrinthique, de glace, d'acier, de béton; chose de chiffres idolâtrant le fantôme de la spontanéité, s'abreuvant de folie à force de sérieux, s'infantilisant pour s'être trop paré de la morgue bureaucratique des comptables.
En toile de fond, Buenos Aires fait gronder son bitume, ses immeubles, ses rails, ses foules. La ville devient un mythe, un Hadès. Elle met les hommes au joug, les lance dans ses gares, ses rues, ses métros. La ville est un incommensurable Léviathan où le cynisme n'existe pas, car la question de l'espoir n'y a plus de sens. L'assouvissement du désir, si rarement éprouvé, se confond avec l’éternelle chimère du bonheur. Le monde s'impose à lui-même, la ville contraint à l’acceptation, espace sauvage et rationnalisé, où les hommes pestent contre leur sort en murmurant, où le malheur advient comme une salvation.
La danse du feu d'Arlt met en place des perspectives vertigineuses sur l'asservissement de l'homme moderne par les mirages qu'il fomente, ses soifs de bonheur invertébrées et ses minuscules jouissances. Sa Buenos Aires est une ville éternelle, théâtre d'un crépuscule des Dieux qui s'éternise, d'une chute qui est devenue la vie.